Certaines perceptions sociales et de nouvelles idéologies découlent des événements mouvementés, entre mai 1891 et juillet 1894. Des systèmes formels de pensée naissent d’observations relatives à la conjoncture de l’époque. Le militantisme ouvrier, la terreur anarchiste, les résultats électoraux socialistes et autres signes de désaffection sociale représentent des facteurs essentiels pour l’analyse de la société. Cependant, la plupart des observateurs cantonnent leur analyse à un niveau d’abstraction relativement peu élaboré.

Pour Émile Durkheim, dont l’avis prendra toute son importance par la suite, les événements renforcent les impressions existantes et aident à la formation d’une expression conceptuelle ou à la formulation d’explications logiques. Aucune de ces analyses ne peut se dissocier du rôle prépondérant joué par la perception des événements. Pour comprendre les idées et la logique de la conceptualisation sociale, il est nécessaire de tenir compte du contenu perceptuel inhérent aux systèmes analytiques [1].
Les événements et la sociologie
Dès août 1892, Jules Huret ébauche dans Le Figaro les possibilités analytiques de la situation politique. Il examine les événements en signalant leur caractère singulier, notamment la faiblesse gouvernementale confrontée au massacre de Fourmies, à la terreur anarchiste et au « phénomène socialiste ». Faiblesse qu’il attribue au manque de décision et de propositions antisocialistes. L’analyse critique de la société européenne faite par Karl Marx, trente ans auparavant, n’aurait eu, selon lui, pour lecteurs qu’une « élite restreinte de travailleurs ». En 1892, les explications marxistes servent à stimuler l’action militante, mais « à cette organisation des forces ouvrières, à cet idéal de matérialisme scientifique, qu’ont opposé les classes dirigeantes » ? Ni programme ni projet de société ne sont opposés à l’analyse sociale radicale. Et Huret d’ajouter : « Au vrai, théoriquement, elles ne se sont pas défendues [2]. » Aucune explication des événements sociaux et politiques n’est effectivement offerte, rien qui puisse être la base d’une analyse scientifique ou d’une défense idéologique de l’ordre social.

Cette défense consista uniquement en des dénonciations du socialisme et de ses dérives idéologiques. Yves Guyot analyse ce phénomène dans son ouvrage La Tyrannie socialiste (1895). Homme politique et éditeur du Siècle, il examine avec cohérence la question sociale sans toutefois développer de théorie. Son étude de la montée du socialisme et de l’organisation du travail depuis la IIIe République, notamment au moment de l’intensification du mouvement social du début des années 1890, est très détaillée.
Il y résume les principaux éléments de la théorie et des tactiques socialistes, la nature du « progrès » social, le problème légal de la représentation collective du travail, la légalité et la psychologie des grèves, enfin la question générale de la « liberté » dans un système politique républicain. Des points qui posent des questions sur la transformation historique et sur l’élaboration d’une dynamique sociale. Guyot revient souvent sur les conséquences de la pensée socialiste et sur la terreur anarchiste en évoquant le pouvoir de cette idéologie et l’hypnotisme des idées fixes [3]. Les socialistes et les révolutionnaires fondent leurs revendications sur une absence de mobilité sociale, ce qui lui paraît crucial pour leur programme : « Ils veulent réserver, ces bons apôtres, toutes leurs forces pour la guerre sociale. Ils sont prêts à fraterniser au-delà des frontières ; mais ils ne pardonneront jamais au paysan d’hier qui, par son travail et son épargne, a pu devenir propriétaire ; au tâcheron ou à l’ouvrier qui a pu devenir patron ; aux fils de tout ce prolétariat qui, par leur intelligence, leur activité, des bourses gagnées aux concours, ont pu devenir ingénieurs, industriels, manufacturiers, commerçants ; car ce sont des bourgeois ! et comme tels des criminels ! C’est contre ceux-ci qu’ils réservent toute leur énergie et leur ardeur. Quelle logique et quelle morale [4] ! » C’est une exagération de la réalité qui s’appuie sur la faiblesse du « socialisme scientifique », notion fondée sur la perception de la société capitaliste comme structure rigide et stratifiée.
Durant cette période charnière, de nouvelles perceptions sociales influencèrent tant la formation des systèmes sociologiques que l’évolution des idéologies. La parution, en 1895, de La Psychologie des foules de Gustave Le Bon est emblématique de cette conjoncture politique et intellectuelle. L’auteur considère son époque comme l’« un des moments critiques où la pensée humaine est en voie de transformation ».
« L’âge moderne, dit-il, représente une période de transition et d’anarchie [5]. » Les signes significatifs du bouleversement des mentalités et des idées sont, pour Le Bon, les mouvements de foule : les grèves, les manifestations, les émeutes, les rassemblements politiques. « L’ère des foules [inaugure] l’avènement des classes populaires à la vie politique. » D’où le danger de destruction de la société confrontée à un « communisme primitif qui fut l’état normal de tous les groupes humains avant l’aurore de la civilisation ». Les revendications des masses acculent à l’échec un gouvernement faible dont la seule défense réside dans l’utilisation de la psychologie des foules : « Connaître l’art d’impressionner l’imagination des foules c’est connaître l’art de les gouverner [6]. »
La dynamique de la psychologie des foules représente, à ses yeux, un phénomène alarmant dont il cite les ramifications : les grèves, les syndicats, le socialisme parlementaire, l’anarchisme ou l’agitation des étudiants [7]. D’où l’idée de certains mécanismes d’« imitation », voire de « contagion ». Ce qui induit la définition de foule en tant que masse homogène avec une conscience collective découlant d’un vaste processus de contagion mentale ou de « consensus ». L’émergence d’une conscience prolétaire résulte, à ses yeux, non d’une détermination rationnelle née des conditions de vie ou de travail, mais de la contagion d’une idée et la volonté d’imitation. La propagation des idées revendicatives comme les opinions ou les conceptions alternatives découleraient d’un mécanisme d’imitation. Et ce « mécanisme de contagion », s’il transcende l’intérêt individuel, est irrationnel et dangereux dans un contexte social [8]. Pour preuve de ses assertions, Le Bon rapporte le cas de la grève de conducteurs d’omnibus parisiens (février 1892) qui s’arrêta après l’arrestation de deux des leaders. Sans meneurs, la grève s’arrête et la situation se rétablit à l’avantage de la société [9]. Un article relatant la réunion chaotique de socialistes et d’anarchistes illustre, selon lui, la confusion et l’incohérence du discours révolutionnaire, et les signes de désintégration sociale qu’il recèle [10].
Le Bon attribue cette désintégration sociale à la contagion mentale et à la suggestibilité émotionnelle illustrées par les événements du début des années 1890, en particulier par la terreur anarchiste. L’idéologie socialiste, cause directe de la flambée de violence anarchiste, aurait affecté la classe ouvrière. La répétition de termes-symboles — « démocratie, socialisme, égalité, libertés » —, s’ils répondent à des « aspirations inconscientes », n’apportent pas de solutions aux problèmes. Les revendications deviennent alors irraisonnées et hors de la réalité sociale. Et de conclure : « L’évidente faiblesse des croyances socialistes actuelles ne les empêchera pas de s’implanter dans l’âme des foules [11]. »

Son explication des événements connaît un succès comparable au traumatisme social engendré par les attentats. Le Bon reprend, de manière plus formelle et plus sophistiquée, le discours d’Henri de Kérochant après la mort de l’anarchiste Pauwels, tué par sa bombe à la Madeleine : « On nous dit que l’eau est le véhicule des microbes qui engendrent la fièvre typhoïde. C’est possible. Il y a dans la société actuelle divers éléments de corruption qui servent de véhicule au microbe de l’anarchie [12]. » Contagion, suggestibilité, imitation… Les principes de la psychologie des foules sont là qui expliquent déjà la perception de la désintégration sociale.
La pensée de Gabriel Tarde, plus raffinée en termes conceptuels, développe le principe de l’imitation de Le Bon. Il initie un tournant important de la psychologie individuelle et une approche intéressante de la motivation du comportement de groupe. S’il formule ses principes de base avant 1890, son observation des événements de 1891 à 1894 élargit considérablement son champ de réflexion et aide à la structuration de ses idées. Son attention se fixe particulièrement sur la psychologie des groupes sociaux.

En 1893, il publie un article sur la perception du mouvement social des deux années précédentes. Il qualifie la crise de « crime collectif » dont les relations entre dirigeants et dirigés, et leur responsabilité mutuelle, sont une des composantes. L’émergence de la violence lui apparaît comme un fait sans précédent, mais inévitable « sous l’action prolongée des idées égalitaires ». Cette « nation moderne […] tend à redevenir une grande foule hétérogène, plus ou moins dirigée par des meneurs nationaux et locaux ». Et l’instabilité sociale du pays semble se répandre comme par un phénomène de contagion, les « épidémies de grèves », par exemple [13]. De même, la terreur anarchiste : « Et qu’est-ce, en somme, que la propagande par le fait préconisée par elle avec trop de succès, si ce n’est la fascination par l’exemple [14] ? » Un terrorisme qui résulterait de l’influence de la propagande écrite, dénonciation de la propriété individuelle et du capital.
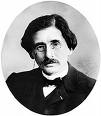
De son observation du mouvement social, Tarde cite de nombreux exemples : la convergence qu’il constate entre la terreur anarchiste et les scandales de Panama. L’optimisme né de « l’infatuation collective » d’avant 1891 est balayé : « Depuis les explosions à la dynamite et l’affaire du Panama, je ne pense pas que ce langage soit encore de mise. Il y a quelque chose de trop significatif dans la coïncidence de cette épouvante et de ce scandale, l’une révélant les désespérances et les haines d’en bas, l’autre, la démoralisation et les égoïsmes d’en haut. Et le tout coïncide trop bien avec les courbes ascendantes de la statistique criminelle [15]. »
Les différentes formes de violence déclenchées provoquent de nouvelles associations idéologiques. En observant les grèves, les actes terroristes et la corruption des politiciens véreux, Tarde y voit l’amorce d’une désintégration sociale. Une perception qu’Émile Durkheim fait ensuite coïncider avec les exigences politiques et idéologiques de l’État.
Adaptée à la réalité sociale de la France industrielle de la fin du XIXe siècle, l’œuvre de Durkheim se construit autour d’une structure analytique où les événements des années 1890 ne jouent qu’un rôle secondaire, mais néanmoins préparent un terrain favorable à sa perception de la réalité sociale en milieu universitaire comme dans l’opinion publique.
Le Suicide, paru en 1897, est une analyse sociologique dans laquelle la désintégration sociale tient la place centrale. L’aliénation de la classe ouvrière y est démontrée face aux structures sociales et aux processus politiques de la IIIe République. Le suicide est un indice de l’aliénation sociale et sa multiplication, au vu des statistiques de l’époque, est une preuve de la désintégration sociale. Il voit le suicide comme le signe d’une condition sociale généralisée qu’il appelle « anomie », sentiment de rupture entre la société et les individus. L’anomie s’est accrue depuis plusieurs décennies, et se retrouve particulièrement « dans une sphère de la vie sociale où elle est actuellement à l’état chronique, c’est le monde du commerce et de l’industrie ». Le « progrès économique […] a principalement consisté à affronter les relations industrielles de toute réglementation [16]. » D’où une transformation profonde dans la pratique industrielle et les bouleversements sociaux. Les travailleurs ne sont plus disciplinés par la religion, ni protégés socialement, et cherchent à fuir une société sans cohésion morale. Un « état de crise et d’anomie » qui génère « l’effervescence sociale » et l’attirance vers les idées alternatives, utopiques et révolutionnaires. Qu’il s’agisse de l’anarchiste, du socialiste, du mystique ou du révolutionnaire, ils partagent la même critique de la société et aspirent au même désir de la détruire. Le suicide représentant une des composantes de cette destruction [17].

Selon Durkheim, l’anomie est une condition produite par les rapports sociaux. En cela, il contredit Tarde et Le Bon qui fondent le mode de comportement des masses sur un mécanisme d’imitation et de contagion. Pour Durkheim, s’il reconnaît que la contagion et l’imitation sont des mécanismes de la psychologie sociale, les incertitudes et les angoisses engendrées par l’absence de liens sociaux associées à un terrain idéologique favorable sont des facteurs plus déterminants. L’attirance dépend de la réceptivité du sujet et non du contenu des idéologies.
Dans ce contexte, les actions perpétrées au nom d’un idéalisme social et politique seraient des actes d’autodestruction : « Aujourd’hui, en dehors des quelques milieux spéciaux et peu nombreux comme l’armée, le goût de l’impersonnalité et du renoncement est trop prononcé et les sentiments contraires sont trop généraux et trop forts pour rendre à ce point facile l’immolation de soi-même. Il doit donc y avoir une autre forme, plus moderne, du suicide, susceptible de se combiner avec l’homicide. » Forme moderne de suicide ou suicide anomique, cette notion permet d’associer suicide et meurtre dans une même impulsion exprimée diversement. Le malaise social revient, selon Durkheim, à initier une impulsion qui se retourne contre le sujet dans le cas du suicide ou contre un autre dans le cas d’homicide. Il précise toutefois : « Un homme de moralité médiocre tue plutôt qu’il ne se tue [18]. »

Comment analyser l’acte de Geronimo Caserio en s’appuyant sur la thèse du suicide indirect de Durkheim ? L’assassin de Sadi Carnot n’a fait aucune tentative de fuite après son attentat et est jugé sain d’esprit et responsable de son acte. Si l’on refuse la thèse de l’attentat contre le système et au nom de la révolution, Caserio aurait-il tué Sadi Carnot par faiblesse de se donner la mort ? Cette explication est celle qui est retenue et qui prime encore. Les terroristes anarchistes sont alors considérés comme des « fanatiques » ou des « extrémistes », hypnotisés par les idées socialistes et victimes pathétiques d’une société en déséquilibre. Les auteurs des attentats-suicides de notre époque sont-ils jugés autrement de nos jours ?

Si le suicide et le terrorisme, comportements anomiques, découlent de la désintégration sociale, qu’en est-il des revendications socialistes, du militantisme pacifique et de l’agitation ouvrière ? Ils sont la conséquence de la division du travail. La structure sociale ne nécessite pas, en effet, de modification profonde puisque les conditions de vie évoluent vers une amélioration. Le malaise social est en fait « une alarmante misère morale » et le remède proposé par Durkheim est la « moralisation » des travailleurs [19].
Fermement opposé à l’agitation ouvrière, aux idées socialistes, à l’anarchie et à toute expression de mécontentement social, il tente néanmoins d’expliquer les signes de désintégration sociale en termes sociaux et historiques. Une analyse qui érige les perceptions de la société en principes scientifiques. La psychologie de la classe ouvrière intéresse l’État comme les révolutionnaires, notamment dans le cadre de la prise de conscience de son aliénation. De cette question psychologique et culturelle dépendent l’intégration de la classe ouvrière et l’avenir de la société.
Les grèves, les émeutes et le terrorisme sont une conséquence de l’industrialisation. Ces événements ont révélé non seulement une transformation profonde et irréversible des liens sociaux, mais également la nécessité d’adopter des méthodes plus adaptées et plus subtiles de contrôle social. Les succès électoraux des politiciens socialistes ont influé sur une nouvelle stratégie électorale. Les promesses électorales de réformes sociales sont un aspect de celle-ci, l’utilisation de la crainte du mouvement social en est un autre. Les événements du début des années 1890 ont contribué sur tous les plans à une transformation sociale.
