
L’ouvrage de Laura Castellanos est indispensable pour qui veut connaître cette période de l’histoire mexicaine, bien différente de l’histoire officielle. Son travail est en effet une référence pour tous ceux et celles qui luttent pour le droit à la vérité sur les événements de ce que l’on appelle la « guerre sale ». Le Mexique en armes. Guérilla et contre-insurrection 1943-1981 traite de la radicalisation du mouvement populaire mexicain et révèle les violations des droits humains commises par les acteurs de la stratégie contre insurrectionnelle.
Pour mener à bien ce travail de journaliste d’investigation, pour croiser les informations et les témoignages, il n’a pas fallu moins de dix ans de recherche pour éclairer des faits passés sous silence par les autorités et les médias, ou revus par le filtre de la propagande.
Ce qui ressort de cet ouvrage, c’est la permanence de l’oppression dans ce pays. Les massacres d’étudiants en 1968 sont connus, mais on ignore souvent les luttes qui n’ont cessé dans un Mexique décrit comme le refuge des exilés politiques des pays d’Amérique latine sous dictatures. Au plan international, les gouvernements mexicains ont eu des gestes et des déclarations en faveur de victimes des régimes militaires et totalitaires, en revanche, au plan national, ils n’ont pas hésité à employer des moyens similaires et la répression la plus féroce.
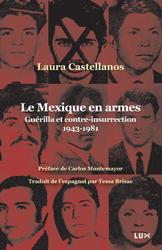
L’utilisation de groupes paramilitaires, la violence, les punitions collectives, les arrestations, les disparitions, la torture à l’encontre des opposant-es ne sont pas seulement le fait des pays voisins. Ce type de traitements contre l’opposition sociale et politique au Mexique n’était guère évoqué alors que la barbarie était dénoncée en Argentine, au Chili, au Paraguay, en Uruguay, en Bolivie, au Brésil, au Guatemala, au Salvador… Or, l’on découvre, dans le livre de Laura Castellanos, la responsabilité des dirigeants mexicains à travers la litanie d’exactions engendrées par la paranoïa et la phobie du complot révolutionnaire, mais aussi par l’influence des Etats-Unis — le plan Condor — sur tout le continent et, bien entendu, le refus d’accéder aux revendications sociales et politiques des populations.
« Vers l’extérieur, le geste fraternel. À l’intérieur du pays, des centaines d’hommes et de femmes disparus ont été enlevés, et exécutés ou séquestrés dans des prisons clandestines, accusés d’activités subversives. La majorité d’entre eux étaient des paysans du Guerrero, mais une autre partie importante était issue des rangs des étudiants des villes, anciens militants des JC ou chrétiens radicalisés qui avaient pris les armes après avoir assisté aux massacres de 1968 et 1971 dans la capitale, ou à la répression des mouvements étudiants du Michoacán, de Puebla, du Jalisco, du Chihuahua, d’Oaxaca, du Nuevo León, du Sonora et du Sinaloa. »
À la lecture du Mexique en armes. Guérilla et contre-insurrection 1943-1981 de Laura Castellanos, on comprend mieux les événements du Chiapas en 1994, de même que la radicalisation d’une partie de la société mexicaine depuis quelques années. Phénomène qu’elle aborde dans une partie de l’entretien qu’elle a accordé aux Chroniques rebelles durant le Salon du livre libertaire, à Paris, le 9 mai dernier.

De retour au Mexique après son voyage en Europe, Laura Castellanos a pu constater, à ses dépens, que les autorités mexicaines n’hésitent pas à utiliser l’intimidation contre celles et ceux qui font un travail d’investigation pour une information indépendante. Mener une recherche à propos d’une autre histoire que l’histoire officielle, comme partout, cela dérange. Le journalisme d’investigation est un travail à risque dans de nombreux pays.
Dans un climat marqué par la violence et l’impunité, Laura Castellanos a été la cible de harcèlement en raison de son travail de journaliste et de ses reportages sur les groupes armés et les mouvements radicaux au Mexique. La récente violation du domicile de Laura Castellanos s’ajoute à une longue liste d’actes d’intimidation qui comprend menaces téléphoniques, piratage de son courrier électronique et surveillance constante.
« Je suis consciente, a-t-elle déclaré, que l’objectif est de m’intimider et de me faire taire. Or, maintenant que j’ai décidé de continuer mon travail, ce qui m’inquiète vraiment, c’est le fait que ces actes sont de plus en plus menaçants. »
Il s’agit donc d’exprimer notre solidarité à Laura Castellanos qui écrit :
« Les retards catastrophiques du pays en matière économique, sociale et démocratique, donne à l’histoire de la guérilla au Mexique une actualité qu’il est important d’analyser et de comprendre, pour pouvoir éradiquer les causes qui la font exister, non par des mesures militaires, mais avec de véritables actions de justice sociale. »

Claude Rioux [1] : Il existe peu de littérature sur la question des groupes armés au Mexique et le livre de Laura Castellanos comble à coup sûr cette lacune. Après l’élection de Vicente Fox, en 2000, une commission d’enquête sur les responsabilités de la “guerre sale” fut mise en place, les archives furent ouvertes, ce qui a permis à Laura Castellanos et à une équipe de chercheurs d’accéder à des documents et à des témoignages. Elle a, par ailleurs, fait plus d’une centaine d’entretiens et une recherche dans toute la presse mexicaine du XXe siècle.
Le livre débute dans les années 1940 avec Juben Jamarillo — qui a combattu très jeune avec Zapata et vient comme lui de la région du Sud —, leader d’un mouvement d’auto défense paysanne pour le contrôle de la terre. Mouvement qui a été torpillé par le pouvoir et la corruption. Le Mexique en armes se poursuit dans les années 1960, au Nord cette fois, avec la première génération d’instituteurs ruraux qui prend les armes contre la misère. À la fin des années 1960, dans l’État du Guerrero qui s’embrase, c’est le célèbre guérillero Lucio Cabanas.
Dans les années 1970-1980, les mouvements se convertissent en mouvements armés urbains, avec la participation de nombreux étudiants, qui pratiquent les attaques de banques, les enlèvements contre rançons… Des mouvements similaires à ceux qui existent en Europe à la même époque. Dans l’épilogue est traité ce qui fait le lien entre ces mouvements et l’armée zapatiste de libération nationale, de l’armée populaire révolutionnaire, de même qu’une trentaine de mouvements armés dont certains demeurent encore aujourd’hui. L’intérêt du Mexique en armes est d’aborder un sujet rarement évoqué et de dévoiler l’ampleur de la répression et ses pratiques, les vols de la mort, les disparitions, les camps
de détention clandestins, la torture… Ce sont aussi des réalités mexicaines qui perdurent encore aujourd’hui.
Christiane Passevant : Laura, tu emploies un style direct de journaliste et de conteuse. Comment as-tu conçu ton livre ?
Laura Castellanos : D’abord comme une chronique journalistique, mais avec une part de subjectivité. Je ne crois pas à l’objectivité, car j’ai donné la parole aux protagonistes, aux témoins qui ont vécu ces événements. En revanche, j’ai travaillé avec rigueur sur la période historique pour mettre en contexte les témoignages et les récits. Les sources importantes de ce travail ont été les journaux de l’époque. Les autorités ont donné leur version des faits et leurs discours sur les événements, leur stratégie contre les guérillas. Il fallait à la fois décoder les informations et ne pas mythifier l’action des guérillas. Cette histoire n’a jamais été écrite auparavant et était dédaignée par la gauche établie. C’est le premier livre qui donne une vue panoramique de ces mouvements.
Pour la narration, j’ai pensé aux lecteurs et aux lectrices qui feraient la découverte de cette histoire mexicaine, c’est pourquoi j’ai voulu employer un langage direct pour recréer visuellement ces moments et ces événements, et transcrire aussi la voix des témoins.
Christiane Passevant : Comment ton livre a-t-il été reçu au Mexique ?

Laura Castellanos : Sa publication date de deux ans, par une maison d’éditions de gauche, ERA, qui publie des ouvrages sur l’histoire mexicaine. Vite épuisé, il a été réimprimé. Je l’ai dédicacé aux jeunes, nés après 1968 [2]. Le livre a très bien été accueilli dans les universités qui le donne aux étudiants en histoire, sciences politiques et en journalisme.
Christiane Passevant : L’ouvrage montre bien la continuité de la résistance, qu’il s’agisse des paysans, des instituteurs, des intellectuels, des jeunes…
Laura Castellanos : Pour comprendre la situation actuelle, il faut connaître l’histoire et les enjeux des luttes radicales depuis la révolution mexicaine de 1910-1917, notamment la constante exigence du droit à la terre. Si l’on pense aux jeunes qui ont pris les armes dans les années 1960-1970, il y a incontestablement une continuité avec les luttes d’aujourd’hui, celles des zapatistes et de l’armée populaire révolutionnaire. Si une dizaine de groupes sont actuellement en période de repli, il faut tout de même souligner que les zapatistes contrôlent un territoire où vivent pas moins de 40 000 personnes et qu’ils ont rompu avec le gouvernement en place.
Christiane Passevant : Ce qui ressort aussi de ton livre, c’est la place des femmes. À commencer par Epifania, compagne de Jamarillo…
Laura Castellanos : Un de mes objectifs était de donner une visibilité aux femmes dans les luttes. Mais cela n’a pas été facile de les faire parler sur leur participation, de les convaincre de témoigner sur leur rôle dans ces mouvements. La fille de Jamarillo, seule survivante du massacre de la famille, a mis huit mois pour répondre à ma demande d’entretien. Et lorsqu’elle a accepté, elle hésitait à parler d’autres personnes que son père. Même chose pour des compagnes de guérilleros.
Christiane Passevant : Pour revenir à Epifania, il semble que cette femme de caractère était critiquée par l’entourage de Jamarillo. Était-ce en tant que femme qui se mettait trop en avant ou bien était-elle difficile ?
Laura Castellanos : Pour les deux raisons. Mais ce couple était admirable dans le contexte rural des années 1940 au Mexique. Le mouvement de Jamarillo avait inscrit les droits des femmes dans leur programme. La question des femmes est essentielle, d’ailleurs dans les années 1960, ce sont les femmes, les mères, les compagnes, les
sœurs des disparu-es et des prisonnier-es qui ont affronté le système, sans être elles-mêmes impliquées dans la politique ou avoir été formées. Elles visitaient leurs proches en prison, s’élevaient contre la torture, exigeaient des informations sur les disparu-es, des procès justes, la suppression des prisons clandestines. Et même si elles n’étaient pas toujours prises au sérieux, elles ont continué la lutte. Ce mouvement a été l’embryon d’un grand front populaire contre la répression qui a rassemblé des syndicalistes, des paysans, des intellectuels et est devenu le mouvement pour la défense des droits humains au Mexique.
C’est un phénomène similaire à ce qui s’est passé en Argentine avec les mères de la Place de Mai. C’est une révolte spontanée contre la répression. Après le massacre du 2 octobre 1968, suivi d’un autre massacre d’étudiants, le 10 juin 1971, que l’on appelle Corpus Christi, les manifestations publiques ont quasi disparu jusqu’à ce que les femmes manifestent contre les disparitions. Cela a débloqué la situation. Par exemple, en 1978, le parti communiste s’est présenté aux élections contre le PRI. Une opposition pouvait s’exprimer.

Christiane Passevant : Quel est le lien entre les luttes spontanées menées par les femmes et les revendications actuelles des femmes au Chiapas ?
Laura Castellanos : Dans les deux cas, le contexte est différent. Les femmes qui ont revendiqué la libération de membres de leur famille se battaient pour les autres, pas pour elles-mêmes. Les femmes zapatistes d’aujourd’hui se battent d’abord pour leurs droits et pour une amélioration de leur situation, ce qui n’est pas facile car elles sont discriminées à double titre, en tant que jeunes et femmes au sein de la nation mexicaine. Cela a donné lieu à des conflits, à des tensions lorsque des femmes de la classe moyenne urbaine sont venues au début du mouvement. Quand elles sont venues de Mexico au Chiapas pour donner des leçons de féminisme aux femmes zapatistes, elles ont littéralement été expulsées. Les zapatistes ont déclaré qu’elles voulaient construire leur propre féminisme, dans un processus lent et graduel.
Dernièrement, lorsque je me suis rendu au Chiapas, j’ai constaté que les femmes exerçaient à des postes de responsabilités dans les juntes de bon gouvernement, qui sont les nouvelles instances mises en place par les zapatistes depuis quatre ou cinq ans. J’ai vu une jeune fille de 17 ans siéger au gouvernement d’une municipalité autonome.

Christiane Passevant : Tu es féministe ?
Laura Castellanos : Oui.
Christiane Passevant : Qui sont les éco-anarchistes, filles et garçons, au Mexique ?
Laura Castellanos : C’est un phénomène que j’ai étudié avec un collègue, Alejandro Gimenez, dans un reportage pour la revue Gatopardo. Le phénomène est apparu au cours des trois dernières années. La première année, on a recensé cinq actions, mais depuis le chiffre est en augmentation. Le mouvement se revendique du Front pour la libération des animaux et s’attaque particulièrement aux symboles du système capitaliste, les banques, les restaurants de fast food ou les entreprises qui pratiquent des expérimentations sur les animaux. Les militant-es font des actions de sabotage, utilisent même l’explosif. Contrairement à ce qui se passe en Europe et aux États-Unis où le phénomène concerne des personnes entre 20 et 30 ans et plus, au Mexique, les militant-es sont très jeunes, à partir de 15, 16, 17 ans. Le mouvement attire beaucoup de monde et, en 2009, on a enregistré pas moins de 200 actions de sabotage, par exemple à l’explosif contre les voies de transport.
Ce qui rend difficile la répression du mouvement, c’est qu’au sein des groupes, il n’existe pas de leader, les groupes se forment et se défont rapidement, selon les actions et les projets. Je crois que, au plan latino-américain, ce mouvement marque un retour aux luttes de guérilla des années 1970.
Christiane Passevant : Tu écriras sur ces luttes, des articles, ou peut-être un autre livre ?
Laura Castellanos : Un livre qui sera, je l’espère, publié en français par les éditions LUX. (rires)
Christiane Passevant : Et sur les femmes ?
Laura Castellanos : Sur les femmes éco-anarchistes, certainement.

Extrait du Mexique en armes. Guérilla et contre-insurrection 1943-1981.
Guérilla urbaine : ce qui n’était pas dans les journaux (Chapitre 4)
Ce 23 mai 1975, jour de grosse chaleur, Echeverría fait une grande tournée dans la région du Guerrero dévastée par la répression. Cinq mois ont passé depuis la mort de Lucio et le président sait qu’il a une lourde dette envers la sierra d’Atoyac. Il l’a déclaré lui-même à la presse. Quelques semaines après l’entrée en fonctions du gouverneur Rubén Figueroa, il rend visite aux principaux chefs-lieux de la Sierra Madre del Sur qui ont alimenté le PDLP. Il s’arrête à Zihuatanejo, Petatlán, Coyuca
de Benítez, Tecpan de Galeana, San Jerónimo et Atoyac – reconnue comme la commune à problèmes – pour proposer un « pacte de travail
constructif », qui permettra d’en finir avec la « lâche violence ».
Sur la place d’Atoyac, celle du massacre qui a jeté Lucio dans
la lutte armée, les petits yeux d’Echeverría voient, au milieu de la foule de visages de paysans, ceux de femmes en larmes, jeunes et vieilles, qui racontent qu’elles ne savent plus où chercher les membres de leurs familles – on parle de 800 personnes – qu’elles ont vu emporter. Le président les ignore, il est lancé dans un discours de réprimande qui fait directement allusion à l’enlèvement de Figueroa, et qui sera publié dans Excélsior :
Quand on donne un rendez-vous pour discuter les problèmes
des hommes, on doit assumer avec courage la parole donnée et ses conséquences. La facilité, dans les relations de famille, dans la politique, dans toutes les relations entre les hommes, est de commettre des actes de traîtrise et de lâcheté. Soyons courageux, enseignons aux jeunes le droit chemin, prenons connaissance des problèmes et disposons-nous, avec courage, à les résoudre.
Les cris d’Echeverría, en pleine envolée, sont interrompus par
la voix plaintive de María Romelia Martínez : « Je veux voir mon
fils ! Il n’a rien fait, il travaillait son champ ! » Le président répond
immédiatement :
Je viens dire à ces femmes qui me demandent la liberté de leurs
maris ou de leurs fils, que nous examinerons les cas un par un ; que
nous n’aiderons personne qui ait commis un lâche assassinat, mais
que si l’un d’eux a été victime d’une injustice, nous l’aiderons, bien
sûr, comptez sur nous ici à Atoyac.
La promesse flotte dans l’air brûlant, dans la tension de la foule. Et s’évapore aussitôt. La vieille Andrea Pérez de Vargas, le visage innondé de larmes, s’exclame devant le journaliste d’Excélsior : « Il me manque deux fils et un petit-fils : Juan, Agustín et Francisco. » Le désespoir dû à l’incertitude – un des éléments de la stratégie de guerre psychologique – a joué son rôle, car la vieille femme en pleurs exprime le doute révélateur : « Tout ce qu’on veut savoir, c’est s’ils sont morts ou si nous devons continuer de les attendre. »
Les gouvernements d’Echeverría et de Figueroa vont maintenant affronter un autre genre d’armée, fragile et profondément douloureuse. Celle des centaines de femmes de la vie desquelles a été arrachée une autre femme comme elles, paysanne et analphabète, ou qui ont perdu un fils, un frère, un père, un mari. Plongées dans la terreur, la faim et l’angoisse, elles sont aussi chaque jour obligées de passer outre à leur propre douleur non seulement pour rechercher leurs disparus, mais pour assumer seules la responsabi- lité et la garde de nombreux enfants orphelins, d’hommes et de femmes âgés et malades.
Dans l’autre camp, les victimes sont les mêmes. Les mères, veuves, orphelins et autres parents des soldats tombés dans les embuscades, des caciques ou des délateurs exécutés par l’ACNR et le PDLP, et même les fils de Margarita Saad, enlevée et exécutée par les FAR, se sentent eux aussi abandonnés par le gouvernement. Dans un encart publié dans Excélsior le 31 août 1975, ils exigent qu’Echeverría et Figueroa mettent un terme au climat de violence que créent, affirment-ils, les derniers réduits du PDLP.
Eux aussi ont des disparus. Ils demandent où sont les leurs,
en particulier 34 soldats qui sont peut-être tombés au combat ou dans des embuscades, et dont ils ne savent rien. Ils affirment qu’il y a eu 33 personnes exécutées par les guérillas et qu’ajoutés aux soldats disparus, ils ont laissé en tout 300 enfants orphelins. Et ils protestent : « La vie de nos maris ou de nos frères n’a donc aucune valeur ? Le sang de nos pères et de nos frères ne signifie donc pas la même chose que celui de tout être humain ? »
La pluie de pierres
En 1975, Echeverría n’a plus qu’un an à gouverner et il nourrit l’ambition de devenir Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) ou d’obtenir le Prix Nobel de la paix. Cet homme grandiloquent, accusé de populisme et de dogmatisme par la gauche mexicaine, a tenté de se tailler une image d’homme d’État, leader du tiers-monde, défenseurs des droits humains et économiques des pays pauvres, nationaliste, visionnaire. Cette année-là, il envoie un message à l’assemblée générale de l’ONU pour exhorter les pays membres à suivre l’exemple du Mexique, qui a rompu toutes relations avec la dictature de Francisco Franco en Espagne. Il se rend à Cuba, où Fidel Castro le reçoit chaleureusement, car le gouvernement mexicain, résistant aux pressions des États-Unis, a refusé de rompre avec l’île et vient de proposer à l’Organisation des États américains (OEA) de rétablir avec elle des relations commerciales normales.
En 1975, la fureur anticommuniste déchainée par les États- Unis en Amérique latine a fini par engendrer un cauchemar qui déploie ses ailes : le Plan Condor. Les dictatures déjà en place, ou sur le point de s’imposer par des coups d’État, au Chili, en Argentine, au Brésil, au Paraguay, en Uruguay et en Bolivie, créent une base de données commune. Elles mettent en place un réseau continental de services de renseignements qui opère au mépris des frontières pour séquestrer, torturer, violer, faire disparaître ou exécuter des dizaines de milliers d’opposants, hommes et femmes, aux régimes militaires, quel que soit leur pays de résidence. Echeverría, au même moment, gagne la sympathie de la gauche sud-américaine persécutée en ouvrant largement à des centaines de victimes exilées de la dictature chilienne – et plus tard, des dictatures argentine et uruguayenne – la vie universitaire, culturelle et économique du Mexique.
Vers l’extérieur, le geste fraternel. À l’intérieur du pays, des centaines d’hommes et de femmes disparus ont été enlevés, et exécutés ou séquestrés dans des prisons clandestines, accusés d’activités subversives. La majorité d’entre eux étaient des paysans du Guerrero, mais une autre partie importante était issue des rangs des étudiants des villes, anciens militants des JC ou chrétiens radicalisés qui avaient pris les armes après avoir assisté aux massacres de 1968 et 1971 dans la capitale, ou à la répression des mouvements étudiants du Michoacán, de Puebla, du Jalisco, du Chihuahua, d’Oaxaca, du Nuevo León, du Sonora et du Sinaloa. En 1975, tous les groupes armés, sans exception, ont été frappés par la répression et plusieurs ont été définitivement écrasés. À l’époque, le contrôle de la quasi-totalité des moyens de communication empêche l’opi- nion publique nationale et internationale d’avoir connaissance de ce chapitre sanglant de l’histoire nationale qui sera bientôt baptisé
« la guerra sucia », la guerre sale. Il faudra attendre 30 ans pour que s’ouvrent les archives officielles qui établissent la responsabilité de Luis Echeverría.
