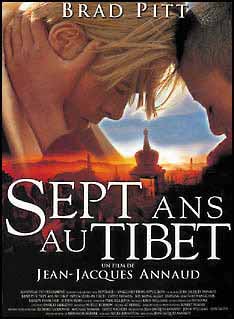Si tout film est un film d’histoire, c’est bien parce qu’il porte les traces de l’époque où il a été réalisé et non parce qu’il choisit de représenter une époque plus ou moins lointaine. Cette loi mise en évidence par les travaux de Marc Ferro et de ses successeurs nous permet de comprendre que "Sept ans au Tibet" le dernier produit de Jean-Jacques Annaud n’apprend rien au spectateur sur les événements historiques utilisés comme support à une fiction destinée au grand public. En revanche, une lecture, à peine soutenue, s’avère riche en enseignements sur cette fin de siècle.
La conception du film comme produit marketing à destination d’un marché planétaire s’inscrit dans une stratégie du cinéma-monde qui cherche à séduire tous les publics. Le film-monde propose donc un spectacle rompant radicalement avec l’offre domestique des images réduites par la censure cathodique et susceptible de convenir à tous les types de spectateurs. "Sept ans au Tibet" offre un divertissement de qualité et, sur les grands écrans des Multiplexes du monde entier, les spectateurs ravis en auront pour leur argent. Le récit, qui respecte tout les canons du classicisme (linéarité, transparence, etc.), se construit à partir d’un itinéraire à la fois géographique et humain (nous sommes en pays connu : Cf. le western) ; le spectateur découvre le Tibet à travers les yeux du grand alpiniste Heinrich Harrer et, dans le même temps, suit son évolution psychologique vers la sagesse. Film d’aujourd’hui évidemment dans la mesure où la relation initiatique entre le père et le fils est inversée : c’est l’adolescent qui révèle la vie à l’adulte et qui fait fonction de père spirituel. Nous sommes bien dans un monde qui marche sur la tête où les pères vont apprendre de leur fils comment se conduire en adulte. Ce lien fort entre deux personnes que tout sépare constitue la colonne vertébrale du film qui tient ainsi grâce à lui. C’est assurément l’aspect le plus réussi et qui conditionne le succès du film auprès d’un large public.
Cette histoire édifiante et bien menée, Jean-Jacques Annaud, dont le métier est indéniable, l’a adaptée de l’autobiographie de Harrer publié en 1953 et traduit en quarante-huit langues. Mais en changeant de média, le débat a été ouvert : le simple passage du livre au film change l’impact. De plus, nous sommes en 1997 et la question du regard sur le bilan du siècle qui s’achève est vraiment d’actualité. Car Heinrich Harrer a appartenu au parti nazi. S’il n’a pas été un criminel de guerre (durant toute la durée du conflit mondial, il était dans un camp de prisonniers en Inde), il a adhéré dans sa jeunesse au SA puis à la SS sous le matricule n°73 896 et c’est à l’intervention directe d’Himmler qu’il doit sa participation à l’expédition qui le conduira dans l’Himalaya puis au Tibet (Cf. Le Monde du 23-24 novembre 1997, p.20). Évidemment sur ces questions susceptibles de cliver les publics, "Sept ans au Tibet" est d’une remarquable discrétion : l’identification des spectateurs au héros ne doit pas être compromise.
En revanche, le film centre son récit initiatique sur le séjour au Tibet qui s’achève par l’invasion du pays par les troupes chinoises. Après avoir éprouvé bien des difficultés à pénétrer dans ce pays replié sur lui-même avec son compagnon, Peter Aufschnaiter, Heinrich Harrer découvre l’Utopie, la vallée perdue. A l’abri du monde, le Tibet est effectivement présenté comme la société idéale. La beauté règne : les jardins sont en fleurs et Bouddha que les femmes sont jolies ! L’égoïsme et l’ambition de Harrer qui le poussent à être premier de cordée (et qui fournissent implicitement une explication psychologique de son adhésion au NSAPD) s’érodent au contact de la philosophie bienveillante des tibétains et du premier d’entre eux, le dalaï-lama. La séquence du patinage où Harrer cherche à séduire la belle tibétaine en faisant le beau est représentative de son apprentissage : son narcissisme échoue lamentablement.
Par un tour de passe-passe idéologique très à la mode, la théocratie bouddhiste se voit décerner un brevet démocratique. Assurément, ce type de confusionnisme est bien d’aujourd’hui. Dans "Sept ans au Tibet", on ne verra jamais comment fonctionne concrètement cette société où il y avait plus de monastères et de moines que dans l’Espagne du XIXème siècle. Le film se garde bien d’aborder des questions aussi triviales que de savoir qui nourrit tous ces improductifs et comment cette société de castes perdure. Ce n’est plus la tarte à la crème du retour du religieux mais bien l’apologie du cléricalisme !
Dans la mythologie, l’Éden est destiné à être détruit et l’homme a en être chassé. Les chinois se chargeront de l’odieuse besogne aidés dans leur noir dessin par un traître parfait, le tibétain occidentalisé. Entre le moment où un tel film a été conçu et celui où il est diffusé, il faut compter des mois voire des années. Néanmoins, sa sortie en novembre 1997 semble avoir été délibérément pensée pour illustrer un des chapitres du "Livre noir du communisme" en tête des ventes dans les librairies lors de la sortie du film. Même si Annaud ne pouvait être en mesure de vouloir prendre parti en réalisant "Sept ans au Tibet" (prise de parti incompatible avec son projet de cinéma-monde), cette rencontre entre le contenu du film et la polémique d’aujourd’hui n’est en aucun cas fortuite ; elle démontre bien la pertinence de l’analyse de Marc Ferro. En effet, nous sommes bien dans l’air du temps quand l’ancien nazi converti à la liberté par le dalaï-lama est confronté, avec amertume, à son passé par la guerre d’agression que conduisent les communistes contre son pays d’adoption ; il ne peut que soupirer : "Dire que j’ai été comme eux !". En une réplique sur quelques images explicites (l’arrogance des officiers généraux chinois dont les bottes piétinent rageusement le Mandala dessiné par les moines en signe de paix), tout est dit : le nazisme est assimilé au communisme, l’invasion du Tibet au dépeçage de la Pologne. Cette équation simplificatrice résume parfaitement une position politique ancienne propre à l’extrême droite visant à s’autoamnistier de son passé douteux. Aujourd’hui, elle tend à déborder largement les rangs des nostalgiques de Vichy ou du Troisième Reich. Elle remplit (au moins) deux fonctions. Une conjoncturelle qui permet de questionner la légitimité du procès instruit à Bordeaux : doit-on juger Papon alors que des collaborateurs des crimes communistes, comme Boudarel ne sont pas inquiétés ? Le procès de Maurice Papon affecte, les réactions l’attestent, la plus grande partie de la classe politique : de la droite traditionnelle (c’est aussi le jugement d’un haut fonctionnaire de de Gaulle et d’un ancien ministre de Giscard) au PS (le cadavre de Bousquet dans le placard du mitterrandisme)... Enfin si le communisme est assimilable au nazisme, une alliance de la droite avec le Front National n’est pas plus condamnable que la présence de ministres communistes dans un gouvernement socialiste.
L’autre fonction plus globale tend à faire accroire que toute contestation radicale de la société libérale est porteuse de terreur et de crimes. Les injustices, les inégalités, les crimes produits par cette société sont regrettables certes mais sans commune mesure avec ceux engendrés par la révolution (si l’arithmétique en l’espèce avait un sens, on pourrait se livrer au comptage des crimes du capitalisme et il n’est pas sûr qu’en additionnant les cadavres des différentes guerres impérialistes, le capitalisme ne remporte pas le trophée). En effet, il n’est pas nécessaire de gratter beaucoup pour trouver derrière l’équation première, une seconde équation qui tend à assimiler le communisme à tout le mouvement révolutionnaire. Depuis 1917, cette équation a servi aux communistes pour construire leur hégémonie sur le mouvement ouvrier et aux défenseurs du capitalisme pour servir d’antidote à la contestation. L’effondrement du mur de Berlin a mis un terme à cette utilisation du socialisme réel comme repoussoir ; aller à Moscou aujourd’hui, c’est faire un voyage dans le temps et retourner aux sources du capitalisme sauvage. Après avoir précipitamment annoncé la fin de l’Histoire, il fallait bien trouver une autre parade idéologique. Par un jeu de poupées russes (sic !), la dénonciation actuelle des crimes du communisme sert à invalider toute remise en cause du système dominant.
Enfin dernier point, cette pseudo-découverte par des staliniens défroqués ex-gardes-rouges insulte l’intelligence des lecteurs de Malatesta, de Gaston Leval et même ceux de Rosa Luxemburg, contemporains de la Révolution d’octobre qui ne se sont pas laissés aveugler par L’autre Flamme (titre du livre de Panaït Istrati, autre témoin contemporain à charge) et ont dénoncé les dérives des bolcheviks dès le début. Alors pour se laver les yeux, il est toujours possible de retourner au cinéma pour voir un film comme "The Full Monty" ou "Marius et Jeannette", films qui n’ont rien de commun avec le cinéma-monde. Et pourtant "The Full Monty" de Peter Cattaneo a battu tous les records du box-office britannique et "Marius et Jeannette" réalise plus d’entrées que bien des grosses machines industrielles. Ces succès disent simplement que la bataille pour la mondialisation du capitalisme n’est pas encore jouée, qu’il existe un public pour ses histoires de petites gens et qu’il est toujours possible d’emprunter les chemins de traverse. Ainsi le succès de "Marius et Jeannette" récompense un réalisateur, Robert Guédiguian, un artisan qui trace son chemin en toute liberté. Enfin réalisé par un communiste, pas très orthodoxe certes, "Marius et Jeannette" brouille les simplifications du discours dominant.
Mato-Topé