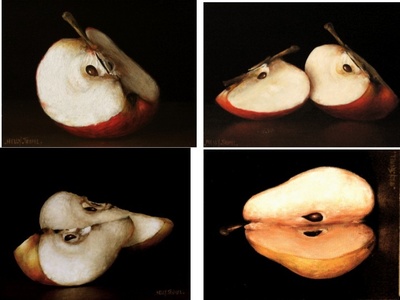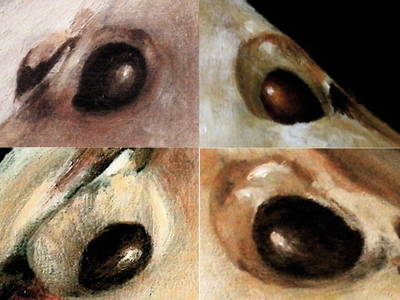Le grand intérêt actuel de Proudhon est d’avoir proposé les grands axes et les principes d’un contre-modèle de société, ni libéralo-commercial, ni socialiste collectiviste. il n’a cependant rien inventé puisqu’il a puisé son inspiration « réformiste » dans la société industrielle naissante, dont il a saisi la direction vers l’avenir (n’en déplaise à ceux qui ne voient en lui qu’une mentalité de paysan ne comprenant rien à la révolution industrielle). Il a simplement transformé les potentialités et les virtualités contenues dans ce qu’il observait et analysait en projet de société, voire de civilisation comme dit l’autre. Par exemple, il a bien vu, malgré ses dangers communautaristes, l’intérêt de l’association (ou des mutuelles, des coopératives, etc.), à condition qu’elle soit généralisée et englobée dans un système général fédérateur, organisé et réglé par des institutions et des normes socio-juridiques révélées par les pratiques sociales elles-mêmes. Et il a mis tout cela sous de grands « principes régulateurs » (il a toujours gardé son Kant à soi tout en procurant des cartes pour le futur) et directeurs : la liberté, la mutualité, la solidarité, la justice.
Ce modèle de société n’a connu que des ébauches, des épisodes et surtout des réalisations éparses. Finalement Marx est plus anarchiste que lui car la société communiste espérée n’est jamais qu’une juxtaposition d’associations autonomes sans régulation (politique et normative) d’ensemble car ledit Marx n’a rien compris à « l’essence du politique », réduit à la domination de classe. Car le marxisme normatif et utopique remplace les atomes individualisés par les molécules groupales prises dans une agitation brownienne sans cadre ni fil directeur. La crise actuelle aurait été évitée dans le cadre du proudhonisme dont les fondements anthropologiques, conceptuels, méthodologiques (dialectique et systémisme, complexité et interdépendance), sociologiques, politiques, juridiques, économiques forment une pensée cohérente aux antipodes de celles du libéralisme et du communisme.
Je dois me situer par rapport à M.Valentin, dont je salue l’excellence du récent livre de citations de Proudhon avec sa préface très documentée et argumentée. Cependant Vincent Valentin tire un peu trop Proudhon du côté du libéralisme. Proudhon, certes, partage avec le libéralisme la priorité des libertés individuelles et des droits personnels vis-à-vis de l’Etat. A ses débuts, Proudhon est même « libertarien », puisqu’il va jusqu’à supprimer l’Etat, le courant libéral se contentant en général d’un petit Etat « veilleur de nuit » réduit à de rares fonctions régaliennes. Il veut développer la démocratie en la rendant réelle. Il tient aussi au marché et à la concurrence économique. Mais Proudhon s’éloigne beaucoup du libéralisme sur moult points.
Ces divergences, présentes dès le libéralisme fondateur des Locke en politique et des Smith en économie, se sont aggravées avec le triomphe du néolibéralisme actuel, lequel mélange sans vergogne politique et économie en rabattant la première sur la seconde. Par ailleurs, il faudrait distinguer les théories libérales des pratiques, les penseurs, plus nuancés qu’on ne le croit, des « libéraux pratiques », à savoir les politiciens, les manageurs, les financiers, les économistes-conseillers des princes et des dirigeants, les experts des institutions internationales (OMC, FMI, BRI, Banque mondiale, OCDE, G de 2 à 77, etc.), les cabinets de conseil et d’audit ou de notation, les journalistes d’influence comme Sylvestre (Grominet) ou le Gaillard (d’avant) qui diffusent, avec les « think tanks » (non pensées réservoirs mais chars d’assaut) et les universitaires patentés des facultés anglo-saxonnes, la vulgate néolibérale depuis 30 ans. Car le libéralisme est en réalité un fouillis, un souk où chacun puise ses petites justifications de l’ordre existant.
En effet, ce qui caractérise le libéralisme dès sa naissance, c’est son flou, son mou, son indétermination. On peut y trouver n’importe quoi. Dès lors, n’importe quel soi-disant libéral peut se parer de ses plumes d’ara (qui rit de ses bons tours) et importer le conservatisme et la réaction en contrebande et en catimini. C’est ainsi que les thèses « hyperlibérales » du libre-échange progressif pour tous les pays et toutes les personnes et de la concurrence parfaite en tout domaine (à commencer par la libre circulation des capitaux) sont présentées comme le substitut final de la politique et de l’État. C’est déjà une 1ère différence notable avec le proudhonisme : celui-ci, dans ses grandes lignes et dans ses articulations entre les domaines (économique, politique, juridique, moral, social, anthropologique, etc.) de la vie sociétale, présente une grande cohérence malgré les contradictions, souvent seulement apparentes, de son œuvre. Mais Proudhon n’a-t-il pas répondu à ses détracteurs que c’était la réalité et non lui qui était contradictoire ?
• Chez lui la propriété, dont il a fait une critique indépassable, n’est pas un droit naturel même si elle est liée au travail. Il ne l’a réhabilitée que comme propriété sociale et comme moyen de défense contre les empiétements du pouvoir politique. Par ailleurs notre penseur admet, dans le care de son pluralisme effervescent, plusieurs modes de propriété : la privée, réduite à l’exploitation familiale par ses propres moyens, la collective notamment avec les coopératives et la sociale avec les « compagnies ouvrières ». Le libéralisme, lui, n’en pince que pour la propriété privée, Dès lors, l’entreprise de droit privé au seul service du propriétaire-actionnaire (souvent des fonds de pension détenteurs d’un gros paquet d’actions), dirigée par des manageurs devant faire mousser « la valeur pour l’actionnaire », sans la considérer aussi comme une institution socio-économique et un capital social, ne se serait pas livré à la maximisation sans freins du profit. Le libéralisme capitaliste commence avec Locke, partisan de l’esclavage et de l’émigration des sans-terres, fondateur d’une démocratie de propriétaires, et finit en loques dans la dérégulation financière.
• Il n’est pas un tenant de l’individualisme (sans même parler de l’égoïsme qui anime bien des libéraux) ; pour lui la personne est une « composition » (Daniel Colson) où le social intervient dès la formation et l’éducation et dans tous les rapports sociaux ; il n’y a pas l’individu d’un côté et la société ou le groupe de l’autre : il y a interaction et interdépendance, il y a les « forces collectives », indépendantes des sujets, il y a les représentations collectives, équivalent idéel desdites forces collectives, il y a la « conscience collective » ou morale, laquelle est « une révélation du collectif à l’homme ». Proudhon est en fait un sociologue, non pas durkheimien mais pratiquement « d’individualisme méthodologique », méthode qui consiste à rechercher le collectif et le sens des structures sociales derrière les pratiques, les mœurs et les représentations. Or la doctrine libérale ignore superbement l’approche sociologique (ou systémique vue par Proudhon dès le « Système des contradictions économiques » et annoncée dans « La création de l’ordre dans l’humanité » avec la dialectique sérielle inspirée par Fourier).
Chez Proudhon, la société est une entité sui generis autocinétique et qui se développe d’elle-même pour produire, par exemple, les institutions du marché ou la monnaie. C’est cet arrière-plan culturel d’individualisme forcené, et non d’individuation personnaliste (normale en tant que désir de reconnaissance et demande d’identité), qui a conduit à la recherche effrénée de la satisfaction individuelle, avec réussite prouvée par l’avoir au détriment de l’être, à l’avidité généralisée des dirigeants de tout poil, aux charognards (modèle Lombard, PDG de France télécom) du « downsizing, du reengineering, du kanban, de « l’empowerment », de la délocalisation, de la sous-traitance, du travail précaire et à temps partiel, de l’effet de levier du crédit, du LBO, du crédit « revolving » à 20% de taux d’intérêt, etc. On observera que cet arrière-plan fricophile et anglophone a été en plus encouragé par la mise en place par les politiciens de structures qui poussent les individus à jouer « perso » : retraites individuelles par capitalisation, assurances personnelles, plan d’intéressement d’entreprises, prêts bonifiés pour l’accession à la propriété, défiscalisation de l’assurance-vie, etc. Qui disait que le libéralisme, c’est la liberté de choix quand les gens ne peuvent plus qu’adopter ce vers quoi tout les pousse sans alternative ? Quand faute de pouvoir d’achat par le revenu ils sont obligés d’acheter du low cost produit en Chine et de recourir au crédit usuraire des cartes de crédit ?
• L’homme n’est ni bon ni mauvais par nature, car il est le fruit, autonome et indéterminé certes, des groupements sociaux et des institutions sociales ; or une bonne part du libéralisme est fondé sur la nature pécheresse de l’homme, qui agirait aussi par « sympathie » imitatrice vis-à-vis de ceux qui ont réussi (A Smith). Du reste, c’est parce que ses « vices privés » « naturels » existent qu’il s’ensuit des « vertus publiques » grâce au « doux commerce ». L’homme est mû par des intérêts et maximise ses utilités, car « on n’attend pas son dîner de la bienveillance du boucher ». Chez Proudhon, ceux-ci ne suffisent pas ; il faut aussi des valeurs. Une association durable doit être une composition des deux, de même que des personnes et du groupe. Il faut marquer radicalement que l’anthropologie proudhonienne s’oppose à celle des libéraux sur ce point essentiel de la prétendue nature humaine, mauvaise chez l’essentiel des libéraux. Du reste, l’ethnologie moderne a prouvé sans conteste que les cultures sont diverses dans le temps et dans l’espace. Ce que le libéralisme a transformé en relativisme généralisé car cela sert à diviser pour régner. Or chez Proudhon, il y a tout à la fois pluralisme et référents communs ; cela est attesté par l’existence universelle et atemporelle des exigences de justice. Si celle-ci avait été prise en compte depuis le reflux du compromis social fordien des 30 glorieuses, on aurait sans doute évité de voir la part du travail dans le PIB reculer de 10 points dans la répartition du PIB. L’homme est largement forgé par sa socialisation et ce qui doit être fait, c’est encourager l’émergence de structures, institutions, normes sociales qui développent son sens potentiel de la justice. Le néolibéralisme a fait l’inverse : promouvoir l’individualisme et l’égoïsme. Mais il a des excuses : c’était déjà la justification des conduites sociales chez les 1ers libéraux.
• Il répudie la démocratie représentative chère aux libéraux car elle n’est que politique, alors que la société est une composition d’interdépendances entre ses dimensions économiques, politiques et sociales : il faut vaincre « la triple alliance du trône, du coffre-fort et de l’autel ». Il faut combattre à la fois l’exploitation économique, la domination politique et l’hégémonie idéologique ou spirituelle, comme l’a analysé, bien après, Antonio Gramsci. A la démocratie purement politique et au fédéralisme du même tonneau, il substitue son fédéralisme décentralisé tout à la fois politique, économique et social. De plus, les libéraux conçoivent le plus souvent l’Etat comme extérieur, supérieur et antérieur à la société civile. Or le pouvoir politique n’est pas une instance externe chargée de réguler la société même sous forme d’Etat minimal, ce qui suppose qu’il est au-dessus ; il est dedans bien qu’ayant un rôle spécial de coordination et de mise en relation. En outre, la démocratie libérale est atomistique, ce qui découle de son individualisme foncier. Le suffrage est lui-même conçu sur cette base de la somme majoritaire des zéros individuels donnant l’infini de la légalité bourgeoise, vite transformée en légitimité. Il ne tient aucun compte des attachements et des enracinements dans des groupements naturels ou professionnels ou fonctionnels, qui pourtant sont les lieux des intérêts et des identités sociales.
Cette conception de la démocratie bourgeoise a conduit à confier la destinée des pays, via l’émission de la législation en tous domaines, à des politiciens professionnels, achetés par les lobbys, qui depuis 30 ans ont dérèglementé à tout-va pour donner toute liberté de circulation partout à la finance et au capital au nom de la concurrence, du marché et du libre-échange. Et pour cela, contrairement au discours libéral, il a fallu un Etat fort pour imposer cette dérégulation aux peuples, un Etat sur lesdits peuples et non à leur service comme recherche du bien commun et de l’intérêt général. La démocratie proudhonienne fédérative, généralisée, allant de la « circonférence au centre » et de bas en haut, insérée dans la société civile et non située au-dessus, nous aurait évité la mise du pouvoir politique au seul service des intérêts financiers et économiques. J’en profite pour dire combien M. Rosanvallon, historien, professeur au Collège de France, est à côté de la plaque en ne trouvant chez Proudhon qu’une « démocratie industrielle ». Non Monsieur : elle y est généralisée dans tous les domaines et pour tous les acteurs. Elle est inachevée comme chez vous, mais, justement, l’orientation que vos travaux légitiment contribue à ce qu’elle le soit toujours et même à ce qu’elle soit achevée définitivement par les sicaires du capital. Elle ne repose pas sur un « peuple introuvable » (comme chez Lefort) ; il suffit de le chercher pour le découvrir.
• Le pouvoir politique ne résulte aucunement d’un contrat passé entre le citoyen atomisé et la nation (version de Rousseau qui aboutit à l’horrible souveraineté absolue et indivisible) ou entre les individus eux-mêmes pour donner les lois et le gouvernement (version de Locke). Il est une institution historique de la lente évolution des sociétés, comme la morale, les principes généraux du droit, les normes sociales. Du reste, Proudhon observe que le contrat social libéral est vide de contenu : il ne donne que des droits abstraits et formels sans rien offrir, notamment, en économie ou en matière de droits sociaux. Certes, notre auteur abuse de la notion de contrat, mais celui-ci chez lui est libre, équilibré, symétrique, synallagmatique, négocié en permanence entre les forces sociales, en un mot mutuel. Or qu’a fait le libéralisme pratiqué par les « modernes » depuis 30 ans ? Promouvoir l’inégalité, l’asymétrie d’information, le contrat léonin imposé (contrat d’adhésion), l’évacuation des risques pour les banquiers, renfloués sur les deniers publics, les assureurs et les manageurs (parachutes dorés, stock-options, hellow primes, salaires 50 fois supérieurs à ceux des employés, retraites-chapeaux, etc.). Le tout avec la bénédiction des politiciens professionnalisés et souvent vendus qui, en échange, ont accru drastiquement la répression des petits délinquants et des protestataires tout en dépénalisant les escroqueries économiques en col blanc.
• Le libéralisme est une sorte de matérialisme utilitaire ; l’économie y est présentée comme une (pseudo) science amorale, le droit comme « positif », l’utilité comme le deus ex machina des rapports sociaux facilement rabattus sur les relations marchandes, la politique comme instrumentale et gestionnaire en dehors de fins pour la société. Or Proudhon reste un idéaliste pour lequel les valeurs morales sont au-dessus du bien-être matériel, de l’hédonisme des satisfactions intéressées, de l’eudémonisme du bonheur du plus grand nombre. C’est ce matérialisme et cet utilitarisme qui ont sapé les bases morales du vieux libéralisme et amené à la corruption généralisée des valeurs morales dans un darwinisme social insupportable. L’exigence morale de Proudhon, dans la lignée de Kant, nous aurait limités dans la course au profit et le remplacement de l’économie productive par le casino financier.
• Le libéralisme est « un optimisme du présent » ; il justifie l’ordre existant, soi-disant inscrit dans le droit « positif » et l’ordre naturel. Il efface la notion de projet collectif comme « constructiviste », pourtant liée à l’identité même des groupes sociaux qui veulent « persévérer dans leur être ». Proudhon, en tant qu’anarchiste sociétaire ou socialiste libertaire, veut que tous les groupes sociaux disposent de leur capacité d’acte-pouvoir et du pouvoir de leur être et soient représentés en tant que tels dans toutes les dimensions de la société ; c’est cela la vraie démocratie. Proudhon est un optimiste du futur dans la ligne de Condorcet. C’est en quoi le projet proudhonien aurait pu nous dispenser du quiétisme du progrès technologique cumulatif, de l’optimisme du marché comme meilleur des mondes possibles. Proudhon était notre Candide face aux Pangloss de la « catallaxie, de la main invisible du marché, de la béatitude future promise par la science. Car Proudhon considérait qu’il ne pouvait y avoir de vrai progrès que dans le domaine moral et de la justice.
• Le marché n’est aucunement autorégulateur ; il repose sur des institutions, des structures, des institutions sociales, des normes morales, des règles juridiques qui l’organisent de même que les rapports marchands entre acteurs sociaux. C’est pourquoi Proudhon pensera à organiser toute une série de « contre-structures » et de droits réels qui permettent d’empêcher la concurrence « libre et non faussée » et qui rendent le travail autonome en le libérant du capital. Ces structures sont liées dans une conception et une logique d’ensemble, dans un contexte d’institutions et de normes : le fédéralisme sociopolitique et le mutuellisme économique. Banque du Peuple (socialisation de la monnaie, du capital financier et du crédit), mutuelles, coopératives, assurances, crédit-bail au lieu des fermages ou des loyers secs, magasins généraux, expositions universelles, statistiques générales pour le pays, mercuriales, « compagnies ouvrières » pour les entreprises utilisant beaucoup de forces collectives ou opérant pour des biens publics, formation professionnelle continue, apprentissage comme mode de formation pratique (lié à la formation générale délivrée dans les écoles). Ces institutions ne sont créés ni par l’Etat (en droit) ni par le marché (en fait), lequel n’est pas soumis à quelque équilibre automatique ou à quelque « main invisible » que ce soit. Ces choses-là sont créées peu à peu par les relations et les négociations entre acteurs sociaux. Comme Proudhon l’écrit : « organisons le droit et laissons faire la boutique » ou « il faut au droit politique le contrefort du droit économique ».
Ces choses proviennent de la dynamique sociétale, de la spontanéité et de l’immanence de la société civile ; elles sont le fruit de « l’action directe » des acteurs en relation les uns avec les autres. Or qu’a fait le libéralisme contre l’émergence de ces contre-structures, qui évidemment ne lui doivent rien puisqu’elles ont été créées à leur début comme des moyens de résistance contre lui ? Il a essayé de les empêcher en les réprimant et en les espionnant, comme les libéraux pratiques au pouvoir ont tout fait pour s’opposer au suffrage universel, à la liberté de la presse ou de réunion, au syndicalisme, etc. Car le libéral a souvent peur du peuple et préfère l’élitisme des « wasps ». Cela se voit très nettement aux USA dans sa constitution et ses amendements qui sont organisés pour réserver le pouvoir aux représentants et sénateurs. Si le tiers secteur social avait été correctement financé (par la banque du peuple de Proudhon), socialement et politiquement encouragé au lieu d’être pourchassé et soumis par l’Europe à la concurrence, à l’heure qu’il est il serait suffisamment puissant pour limiter les dégâts du tout-marché libéral. Les libéraux pratiques, gouvernements en tête, se mettent aujourd’hui à réclamer la régulation du marché. Prise de conscience tardive que la lecture de Proudhon aurait accélérée.
• La solidarité chez Proudhon n’a rien à voir avec le socialisme libéral et « solidariste » cher à Vincent Peillon, qui du reste fait passer pour socialiste une imitation et une perversion de l’idée par les politiciens radicaux. Du reste, cela n’a été mis en place qu’en 1945/46 et surtout cela a consisté à faire payer par le peuple ses propres assurances sous forme de cotisations sociales imposées et étatisées. Belle solution, par ailleurs installée en 1889 par Bismarck pour acheter la paix sociale, qui ne touche en rien à la propriété capitaliste. Chez Proudhon, les mutuelles (sans sélection des risques et en fonction des revenus) d’assurances seraient restées volontaires, auto-organisées et fédérées ; elles n’auraient pas été non plus transformées en pompe à fric pour les fonds de pension et les assurances commerciales. En tant que fruit de « l’action directe » et de la spontanéité des rapports sociaux, en tant que fédérées, elles constituent des contre-structures démocratiques. Ce que Pelloutier a parfaitement compris ; c’est pourquoi il a mis en place « une fédération (à qui Pelloutier a-t-il emprunté ce vocable ?) des bourses du travail, ce qui fait justice de la thèse de jacques Julliard (historien ) prétendant que Proudhon n’a eu aucune influence sur lui, l’anarcho-syndicalisme, puis le syndicalisme révolutionnaire. La Charte d’Amiens de 1906, qui édicte que le prolétariat s’organise sans les politiciens, montre l’influence proudhonienne bien que Proudhon ait refusé les syndicats et la grève puisque c’était inutile dans son système. Grossière erreur qui confond les nécessités de la lutte présente avec la société mutuelliste projetée ou réalisée. Il n’empêche ; la valeur solidarité de Proudhon, associée à la justice, aurait sûrement rogné les ailes du tout-libéralisme égoïste qui a sévi ces dernières décennies. C’est pourquoi Proudhon pense la coopération non pas comme imposée par « une solidarité organique » liée à la division du travail, qui rend interdépendantes les activités qu’elle a séparées, mais comme aussi voulue, projetée en tant que solidarité morale et intersubjective. C’est ce qui caractérise la vraie association fondée à la fois sur des intérêts communs et des valeurs morales et relationnelles.
• Les libéraux aiment la liberté, beaucoup moins la justice. Celle-ci a été réduite à l’utilité commune par Bentham dans la poursuite de la maximisation du bonheur du « plus grand nombre » (ou dans l’optimum de Pareto avec lequel la justice est réalisée quand donner à l’un n’enlève rien aux autres), ce qui permet de sacrifier la minorité, de justifier les inégalités et de donner la primauté au juste matériel (bien maigre) sur le bien moral. Généralement le libéralisme repose sur l’utilité individuelle. Le proudhonisme est fondé au contraire à la fois sur la justice (respect de la dignité de chacun et échange mutuel) et sur la morale : solidarité, mutualité, loyauté, égale considération (réelle) de la dignité de chacun.
Les libéraux ont prétendu que l’Etat et le droit devaient être neutres par rapport aux différentes conceptions du monde et aux différentes morales. Or, le libéralisme repose sur une morale, non ?Mérite individuel, responsabilité, risque (joliment reporté sur tous par le néolibéralisme qui a conduit à la crise actuelle), compétition, austérité épargnante (en principe, car la crise a montré que l’on vivait à crédit…). Est-ce à dire que le libéralisme est en droit de repousser les autres morales, dont la mutuelliste, au profit de la sienne qui a produit la crise actuelle par rapacité et matérialisme du fric parce qu’elle serait universelle et a-historique ? La devise du libéralisme est liberté, propriété, utilité. Celle de Proudhon est liberté, solidarité, justice. Elle empêcherait la justification des inégalités par le libéralisme au nom de la responsabilité individuelle, de la « liberté du renard libre dans le poulailler libre ». Il n’est pas si neutre que cela le libéralisme ; il développe une morale individualiste, matérialiste et utilitariste qui contient en elle-même un totalitarisme de la morale unique, comme une « pensée unique » en matière économique. Ce dogmatisme a légitimé tous les amoralismes d’aujourd’hui car son contenu même le justifiait.
• Les libéraux ne parlent que de droits théoriques subjectifs (des droits de et non à, formels, non réels). Ils prônent les droits-liberté et renâclent devant les droits-participation. Il n’y a pas de droits-créance ou « restitutifs » (Durkheim). Proudhon ne s’en contente pas. Certains droits doivent être aussi réels pour réaliser l’égalité des chances et la symétrie des échanges mutuels. Il ne s’agit pas chez lui d’égalité des conditions, des situations ou des résultats, mais des moyens effectifs procurant à chacun la possibilité de développer son potentiel et ses capacités jusqu’à leur maximum (notamment par l’éducation et la formation professionnelle continue). Si, suivant Proudhon, les droits d’acquisition de moyens concrets d’égalité des chances et d’égalisation a minima des ressources nécessaires avaient été respectés et réalisés, alors le libéralisme n’aurait pas pu donner aux libéraux pratiques les moyens de faire le contraire depuis les années Reagan, Thatcher et Mitterrand. Cela se voit assez nettement dans la conception de la formation que développent les libéraux pratiques : essentiellement pratique, opératoire, professionnelle, limitée « aux fondamentaux » pour le peuple (lire, écrire, compter et … savoir faire des règles de trois comme M. Darcos, ministre de l’éducation nationale, à canal + !).
Chez Proudhon, l’éducation est « démopédie », elle doit former des citoyens capables de participer à tous les domaines de la vie sociale, elle doit donner les moyens d’aller au maximum de son potentiel et de ses aptitudes. Elle est à la fois pratique et théorique ; elle est fondée largement sur le travail à condition que ses savoir-faire soient accompagnés des raisons théoriques de leur fonctionnalité. Les libéraux pratiques préfèrent « l’enseignement simultané » (plus de 35 élèves en rang d’oignons écoutant passivement le maître à l’autorité incontestée (sinon gare aux tribunaux !). Cela permet de faire des économies de professeurs ? Proudhon prône « l’enseignement mutuel » (école de Lancaster, fin du 18ème siècle, début du 19ième !) et la pédagogie active de la découverte (du pragmatiste Dewey). C’est contre celle-ci que les libéraux s’élèvent en démolissant sciemment les IUFM accusés de sombrer dans le pédagogisme au détriment des contenus. Les libéraux tiennent absolument à l’éducation en sus de l’instruction. En fait c’est pour dresser les jeunes esprits à obéir aux figures d’autorité et à respecter l’ordre social « républicain ». Réponse de Proudhon : l’école n’a pas à se mêler de l’éducation car c’est à la famille, 1er espace d’actualisation des sentiments de justice potentiels chez l’enfant, et à « l’atelier », en tant que communauté de travail solidaire, de faire l’éducation morale des jeunes. Les libéraux confient la formation soit à l’Etat soit au privé. Ni l’un ni l’autre chez Proudhon : à une fédération des formateurs et des acteurs par elle concernés et orientée par un 4ème pouvoir politique, « le pouvoir enseignant ».
• Les libéraux disent que la liberté, leur valeur princeps, est antinomique de la liberté. Donc, la justice équilibrante n’est pas la fin première de la société. Ainsi, dans la pensée libérale à la Tocqueville, liberté et égalité sont des contraires inconciliables. Chez les libéraux, la liberté est « négative », c’est-à-dire définie par ce qui est interdit à savoir léser les autres et attenter à leur propre liberté. La liberté proudhonienne est positive ; elle est la possibilité d’exercer sa force, sa capacité, son pouvoir. Car le pouvoir chez lui est la même chose que la liberté ou la force d’agir ; c’est la capacité d’acte-pouvoir » (Dr Mendel) de chacun. Proudhon montre, qu’il ne peut y avoir de liberté sans visée d’égalité, car la liberté conçue, donc, comme pouvoir ou force d’action, est décuplée par la coopération solidaire avec les autres dans des relations personnelles, et pas seulement objectivées dans les marchandises, où on les reconnaît comme égaux, en droit et réellement. Car vous ne pouvez développer des relations coopératives, multipliant les capacités individuelles et collectives, si vous tenez les autres pour inférieurs et si vous les maintenez dans une insuffisance de moyens réels d’agir. Et Proudhon n’a-t-il pas écrit que « l’homme le plus libre est celui qui a le plus de relations ». Proudhon est conscient que la liberté individuelle peut conduire à l’égoïsme et à l’inégalité, mais elle est contrebalancée (composée avec ; c’est la conséquence de sa dialectique des contradictoires et de l’équilibration des contraires) par une dimension sociale, à savoir la représentation, issue du collectif, de la justice, valeur sociale développée lors de la socialisation et du travail. On est loin de la liberté marchande et des inégalités économiques développées au nom du libéralisme moderne.
• Les libéraux, pourtant partisans de la neutralité du droit et de la politique, en ont souvent appelé à « la religion civile » pour pacifier les masses envieuses et dépourvues. Adam Smith n’a pas vu que sa sympathie imitatrice pouvait donner la jalousie (avoir ce que les autres ont) comme ressort du libéralisme économique, mais aussi l’envie (que les autres n’aient pas ce que l’on n’a pas) comme moteur du socialisme collectiviste. Car sans Dieu « tout est permis » (dixit Ivan Karamazov), car sans la religion « rien ne garantit que mon jardinier ne me volera pas » (Voltaire). Du reste, l’ordre néolibéral actuel aux USA, où il n’y a qu’un seul fromage (de Gaulle), ne tient-il pas grâce aux 300 sectes qui y tiennent lieu de religions ? Or Proudhon est non seulement athée mais même et surtout anti-théiste… C’est un humaniste, c’est un personnaliste pour lequel les valeurs spirituelles sont immanentes. Et en aucun cas « les vices privés » ne deviennent des « vertus publiques ». C’est pourtant ce qu’a promu le néolibéralisme soi-disant neutre par rapport aux différentes conceptions du monde. Proudhon nous aurait gardés de cette perversion anti-pluraliste.
• Le libéralisme économique repose sur le profit, devenu rapacité sans limites. Proudhon tient à l’échange « équivalent contre équivalent », au juste-prix, à l’appréciation mutuelle des valeurs échangées. La valeur en économie libérale est devenue l’utilité marginale sur le marché et dans la production. Proudhon prône « la valeur constituée », c’est-à-dire celle qui, eu égard aux différences de productivité du travail, fait que chaque produit ou service a une place relative dans l’échelle socio-économique des valeurs, place qui change avec le degré de productivité. Proudhon maintient donc la valeur-travail, non pas comme mesure absolue liée au temps de travail (même « socialement nécessaire ») mais comme position relative et évolutive. De plus, Proudhon confère au travail en tant que valeur morale et sociale bien d’autres dimensions, notamment celle de lier la théorie et la pratique comme mode universel d’enseignement, comme moteur du pragmatisme, loin de l’empirisme libéral » puisque « l’action revient à l’action sous peine de déchéance de l’agent ». Dans le cadre proudhonien, le travail ne serait pas considéré comme un simple temps d’activité que l’on peut utiliser intensivement par la course à la productivité ou extensivement par le rallongement de sa durée à tous les horizons de la vie de labeur (journée, semaine, mois, année et même sur la vie avec l’augmentation de l’âge de départ en retraite). Chez Proudhon, le travail n’est pas une tâche, un labeur ; c’est une œuvre individuelle et collective dont les fruits doivent être équitablement partagés. Ce n’est pas « travailler plus (lire faire des heures) pour gagner plus ».
• Le libéralisme des origines (plus Hayek) a reconnu l’existence de biens publics que le marché court-termiste et individuellement intéressé ne peut produire ; mais il les laisse à des exploitants et propriétaires privés. Les socialistes collectivistes les étatisent. Proudhon, lui, les socialise, les fédère, les mutualise, en fait une propriété en mains communes de tous les acteurs sociaux, gérée par ses employées et travailleurs. C’est tout le contraire du sabotage des services publics entrepris depuis 20 ans au nom du libéralisme économique et financier. L’économie libérale, transformée en « théorie de l’équilibre général », en théorie de l’offre et en monétarisme est fondée sur l’utilité, la demande solvable de marchandises et de services, l’usage gratuit des « externalités » positives et le non-remboursement des négatives (nuisances en tout genre devenues sources de commerce en tant que « droits à polluer » !), l’accumulation sans fin au détriment de la nature et des hommes et le profit. Proudhon prônait la frugalité, mettait la valeur d’usage au-dessus de celle d’échange, partait des besoins et non de l’offre marchande, situait les relations interpersonnelles bien avant les rapports marchands et aux objets. Si sa leçon avait été entendue, n’aurait-on pas évité le capitalisme sauvage et darwinien en tant que « struggle for life » et sélection des meilleurs, c’est-à-dire des plus riches ?
Non, le proudhonisme n’est pas un libéralisme. Tout diverge : l’anthropologie ou conception de l’homme, la morale comme orientée par la justice, tout à la fois idéelle, idéale et réelle, et la solidarité, la méthode de pensée comme dialectique des contradictoires et systémisme, comme pragmatisme et non empirisme, la sociologie ou conception pluraliste et complexe de la société et des rapports entre individu, groupe, société, la politique comme instance interne à la société et fonction normative, la démocratie comme fondée sur les groupements sociaux en plus des personnes, l’économie comme discipline politique et morale, comme fondée sur la coopération et les « forces collectives », le droit comme substantiel (et pas seulement positif et procédural) en tant que normes sociales instituées et ayant un contenu de droits réels et concrets. C’est tout différent comme type de civilisation de ce que le libéralisme des origines a initialisé et de ce que le néolibéralisme moderne, surtout du côté de ses praticiens, a perverti en règne de l’argent, du capital, de la marchandise et du marché. Evidemment, ce n’est pas un communisme ou collectivisme, non plus. Car « entre la propriété et la communauté, je bâtirai un monde », a-t-il dit. Le contenu même du socialisme collectiviste a conduit au totalitarisme. Celui du libéralisme a ouvert la boîte de Pandore et amené des crises récurrentes, dont celle de 2008 n’est sûrement pas la dernière puisque les libéraux pratiques ne veulent que poser des rustines sur son système socio-économique sans voir que, comme l’avait vu Proudhon, tout se tenait. C’est qu’ils n’ont pas compris que la crise, systémique, était celle de ses fondements : sur la nature humaine, sur la morale, sur la société, sur les relations sociales et humaines, sur les finalités du politique, sur la fonction de l’économie,
sur le rôle de l’argent.