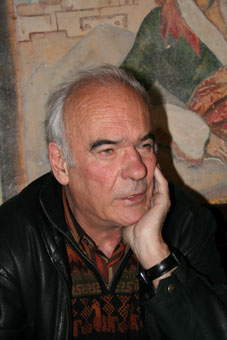Dans un petit ouvrage paru l’an passé, l’anthropologue Jean-Loup Amselle aborde un thème porteur : l’Ethnicisation de la France [1]. Pas si porteur, pourtant, en l’occurrence, au vu du silence qui a accueilli ce livre. Il est vrai qu’il y a différentes manières de se laisser porter. J.-L. Amselle est de ceux qui ne craignent pas de ramer à contre-courant. Publié par une maison d’édition progressiste, on comprend que les adeptes de la « préférence nationale » n’en aient pas fait mention. En revanche, on eut pu attendre d’un lectorat classé à gauche, voire à l’extrême-gauche, qu’il y prête quelque attention. Encore eût-il fallu, cependant, que celui-ci consente à s’extraire de la bien-pensance du politiquement correct qui sévit dans ses rangs depuis maintenant plusieurs années.
Pour résumer la thèse que défend J.-L. Amselle, on fera appel à un sociologue qui lui faisait récemment écho. Dans un article du Monde consacré à la métamorphose de la question sociale en question raciale à laquelle n’a pas peu contribué l’importation en France, au moins sur le plan idéologique, du modèle multiculturel anglo-saxon, le sociologue Gérard Mauger concluait :
« Elle conduit à substituer à une vision du monde social divisé en classes celle d’une mosaïque de communautés ethnicisées et, ce faisant, à renforcer les divisions au sein des classes populaires. [2] »
J.-L. Amselle ne dit pas autre chose, étendant au passage son propos à toutes les théorisations différencialistes issues des campus étasuniens.
« La découpe d’entailles verticales au sein du corps social a eu pour effet de mettre au rancart et de ringardiser la lutte des classes et les combats syndicaux. Il est devenu beaucoup plus chic pour les couches ethno-éco-bobo, ainsi que pour leurs représentants médiatiques, de promouvoir les identités culturelles et de genre (gay, lesbien, queer) que de continuer à accorder une quelconque attention à la « matérielle » comme on disait autrefois. C’est ainsi que toute une logique libérale-libertaire est venue harmonieusement se couler dans le cadre de la segmentation du marché promue par le capitalisme tardif. Les identités fragmentaires ainsi dégagées ont constitué autant de niches de consommateurs traqués par les agences de publicité et de marketing. »
Fragmentation que l’on retrouve dans l’espace urbain où les quartiers anciennement populaires changent d’identité au fur et à mesure de leur colonisation par chaque « minorité » : outre les quartiers ethnicisés, eux-mêmes subdivisés et spécialisés selon l’origine géographique ethnique ou religieuse de leurs habitants, on trouvera des quartiers « gentrifiés » au sein desquels se distingera un secteur à dominante gay ou lesbienne, chacun occupant une place bien définie dans le consumérisme identitaire urbain.
Au slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! », se substitue ainsi, selon J.-L. Amselle, dans l’imaginaire de l’intelligensia de la gauche rénovée, celui de « Minoritaires de tous les pays insurgez-vous ».
Ainsi, « l’indien d’Amazonie devient un symbole beaucoup plus fort de la résistance au capitalisme que l’ouvrier », intégré dans et aliéné par celui-ci, comme chacun sait. « Gardien de la nature, le premier est promu chantre de la « décroissance » et du « développement durable », présentés par les écolos-bobos » — qui sont aussi des gogos —, « comme les seules solutions alternatives au développement de l’économie marchande », cela au moment même où celles-ci servent à la fois de créneau commercial et d’alibi idéologique à l’essor d’un « capitalisme vert ».
« Ce n’est pas l’amélioration du sort des classes ouvrières surexploitées
des pays du Sud (Chine, Inde, Vietnam, Indonésie, Bangladesh…) qui importe », ajoute J.-L. Amselle, « c’est le refus des populations « natives »
de voir leur environnement dévasté par les multinationales. De la sorte, peut s’établir une alliance transnationale entre les couches ethno-écolo-bobo d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie et les peuples autochtones
des pays émergents ». Le maintien de la bio et de la culturo-diversité ainsi que le combat contre la changement climatique, préalablement déconnecté de la lutte contre le mode de production capitaliste qui l’engendre, deviennent des causes qui sont d’autant plus en phase avec les classes moyennes urbaines diplômées qu’elles ne les menacent pas dans leur mode de vie. Plus de révolutions sociales, plus de luttes syndicales, plus de défense du secteur public, des conquêtes sociales. Il ne s’agit, en effet, selon l’anthropologue, que de « justifier l’utilité écologique, culturelle voire
“civilisationnelle” des fonctions et des postes occupés ».
Ce à quoi s’attaque J.-L. Amselle, c’est à une idéologie en passe de devenir dominante dans certaines sphères intellectuelles : le culturalisme. « La hantise de l’Islam, la polygamie, l’excision, les minorités visibles, la diversité, l’identité nationale », tout se passe, note l’auteur, comme si « les grands débats qui agitent nos sociétés étaient essentiellement d’ordre culturel ou ethnique ». Ainsi en va-t-il de celui portant sur les « violences urbaines ».
À lire nombre d’ouvrages, articles ou entretiens émanant de représentants de la mouvance « progressiste », la cause des émeutes de l’automne 2005 en France serait entendue : la « crise des banlieues » serait imputable à un « modèle républicain d’intégration » pseudo-égalitaire qui nierait ou oublierait les discriminations racistes d’origine coloniale. Autrement dit,
sous prétexte que l’égalité n’est pas réalisée entre les « immigrés
post-coloniaux » ou leurs descendants, et les Français dits « de souche », c’est au principe égalitaire lui-même qu’il conviendrait de s’en prendre, et non aux rapports de classe qui empêchent l’égalité « en droit » proclamée depuis des lustres entre les individus de l’être aussi en fait.
Cette antienne contre l’« égalitarisme » est reprise aujourd’hui par des chercheurs français (sociologues, politologues…) qui prônent l’importation
du « modèle d’intégration » made in USA pour résoudre la « question ethnique ». Solution illusoire au vu de ce qu’il en est advenu aux
États-Unis, en Grande-Bretagne ou aux Pays Bas. Ce modèle combine
la « discrimination positive » pour les meilleurs qui parviendront ainsi à s’extraire de leurs ghettos, et le communautarisme pour les nuls qui y resteront entre eux, mais sans être tentés, comme en France, de confronter leur misère à une quelconque promesse égalitaire, avec les frustrations et les rancœurs, voire la rage et la haine, que suscite inévitablement le fait que cette promesse ne soit jamais tenue.
Pour les adeptes français de cette solution, les raisons des émeutes récentes sont avant tout « ethniques ». « Notre grille de lecture individualiste républicaine empêche de voir autre chose que la question sociale de la pauvreté », opine par exemple Marcel Gauchet. « Elle tend à ignorer la dimension communautaire et la question culturelle qui sont pourtant au centre aussi bien de la sociologie de l’immigration que du processus d’intégration. [3] » La révolte des jeunes des cités prendrait
ainsi racine dans une « une identité » de « descendants d’esclaves »,
d’« ex-colonisés », d’« indigènes de la République », victimes du
« néo-colonialisme républicain », du racisme et des discriminations ethniques, condamnés à « l’exclusion » sur le seul critère de la couleur
de leur peau ou de l’origine africaine ou antillaise de leurs ancêtres.
Dans cette perspective, il s’agit, en quelque sorte, de revendiquer et d’imposer la reconnaissance d’une identité spécifique dont on réclame par ailleurs, de manière quelque peu paradoxale, l’abolition puisqu’elle engendrerait des discriminations. Autrement dit, les facteurs de disqualification que sont la couleur de la peau, l’« étrangeté » du
patronyme ou le lieu disqualifié de résidence pourraient être convertis en supports d’une affirmation identitaire positive qu’il suffirait d’encourager
et de promouvoir, institutionnellement et financièrement, pour permettre
aux « minorités visibles » [sic] de vivre « égales aux autres, mais séparées
d’elles ». Cette thèse « communautariste » (i. e. revendiquant une
« culture », une « identité » propres) avait reçu le renfort de… Nicolas Sarkozy. Ministre de l’Intérieur à l’époque, mais également ministre
des Cultes, qui, à ce titre, flattait les représentants reconnus de
l’« Islam modéré » en espérant par leur entremise calmer le jeu dans les cités.
De ce point de vue, l’adversaire principal et prioritaire est alors la
République ou plutôt le républicanisme identifié à un « universalisme abstrait » brutalement « assimilationniste » qui rejette ou infériorise ceux qui sont « différents ». Au contraire, le « multiculturalisme » et le « communautarisme » permettraient aux « minorités » d’entretenir et revivifier leur culture, leur langue, leur mémoire, leurs mœurs propres. Cette marge d’autonomie leur serait accordée non seulement dans
les domaines relgieux et culturels pour préserver et consolider leurs
« différences », mais aussi dans le domaine économique et politique
où, sous couvert d’« empowerment », c’est-à-dire de renforcement de leur capacité d’auto-organisation, on les inciterait à enrayer par eux-mêmes l’empoorishment, la paupérisation, ce qui reviendrait pour eux, en fait, à autogérer leur pauvreté. Sans faire disparaître pour autant, ni même diminuer, les inégalités socio-économiques dont pâtit la majorité.
Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne ou ailleurs, l’émergence d’une (petite) bourgeoisie « de couleur » n’a pas mis fin à la paupérisation et à la marginalisation d’un (sous-)prolétariat « de couleur » qui n’a cessé de croître parallèlement.
Mais peu importe. Les émeutes de novembre 2005 ont été idéologiquement instrumentalisées pour défendre une « nouvelle » cause : acclimater « le communautarisme » en France. Ainsi exaltera-t-on « une nouvelle culture urbaine « métissée » qui se construirait dans des territoires qui ont échappé à l’influence du modèle centralisé et laissé la place à l’« invention de traditions » : références, histoire, langues, pratiques sociales se redéfinissent dans un précipité original qui percute les normes de l’ordre social ancien [4] ». L’ordre en question n’est évidemment pas celui, foncièrement inégalitaire, propre à la société de classes capitaliste. Outre-Manche comme outre-Atantique, cet ordre s’accommode fort bien de
l’« altérité » comme « composante essentielle des relations sociales et des débats de société [5] ». Quelle soit de caractère ethnique, culturelle ou sexuelle, sa « légitimité » et sa « reconnaissance » ne posent pas de problème insurmontable pour peu qu’elles ne mettent pas en cause celles du système social, ainsi qu’ont pu le vérifier a contario et à leurs dépens les militants du « black power ».
Cela n’est pas le cas du « modèle républicain » à la française, où l’impératif de « l’égalité de tous en droits » traîne comme un boulet, aux yeux de ses contempteurs, l’épineuse « question sociale » de l’égalité des conditions qui ne se limite évidemment pas à celle des « immigrés » et de leurs descendants post-coloniaux. N’en déplaisent aux « indigènes de la République » et à leurs séides intellectuels, « l’égalitarisme de façade des structures de la société française » ne les a pas attendus pour révéler ses
« défaillances » ou son « hypocrisie » : Marat, Babeuf, Hébert et autres « extrémistes » révolutionnaires la dénonçaient déjà comme un subterfuge bourgeois avant même que le mouvement ouvrier et ses théoriciens ne prennent la relève. Contrairement à ce racontent nombre de Diafoirus philosophiques qui ne semblent connaître de Marx que ce qu’on en dit dans les milieux qu’ils fréquentent, celui-ci n’opposait pas la liberté et l’« égalité réelle », mais s’échinait à démontrer que l’une et l’autre ne pouvaient être que formelles tant qu’on laisserait le « renard libre » — l’exploiteur — vaquer à son aise dans le « poulailler libre » — le « libre marché ». Mais mieux vaut s’en prendre à un mythique « modèle français d’intégration républicaine », qu’à ce que cette mythologie a pour fonction de camoufler : le maintien et la reproduction de rapports structurels de domination qui, aujourd’hui comme hier, font de l’« égalité républicaine » une fiction.
En cela au moins, ils rejoignent Nicolas Sarkozy qui déclarait :
« Le premier j’ai dit que le modèle social français était à bout de souffle. Le premier, j’ai dit que l’intégration à la française était un échec. Parmi les premiers, j’ai dit que les banlieues étaient des poudrières, qu’il fallait faire une place aux musulmans de France, qu’il fallait engager le pays sur la voie de la discrimination positive à la française en faisant plus pour ceux qui ont moins. »
Trevor Phillips, président de la Commission pour l’égalité raciale au Royaume-Uni et conseiller de Tony Blair, souscrivait lui aussi à cette vision
« raciale » de l’émeute :
« Ce qui se passe […] démasque la fiction selon laquelle il n’y aurait pas de problème racial en Europe. C’est ce qu’on prétendait en Allemagne ou en France, où l’on se refuse à identifier ou à comptabiliser les minorités ethniques. En outre, une certaine gauche niait la dimension raciale des problèmes réduits à des conflits de classe ou seul poids de la pauvreté. »
Sans méconnaître que les inégalités sociales (de classe) sont en effet souvent redoublées par des discriminations racistes pour l’accès à l’emploi ou au logement, cette thèse appelle au moins une triple critique.
Elle méconnaît d’abord que l’origine de la ségrégation, tant spatiale que scolaire, réside dans les inégalités de capital économique, pour la première, et de capital culturel, pour la seconde. Et il se trouve que les plus démunis sur les deux plans sont fréquemment des immigrés récents ayant fuit la misère et/ou la guerre dans leur pays, ou leurs descendants, voués aux tâches les plus déqualifiées de la division capitaliste du travail. Si l’on ne s’attaque pas à celle-ci, on ne mettra pas fin aux discriminations. Cette thèse ignore, ensuite, les effets de l’inflation-dévaluation des titres
scolaires qui condamnent au chômage de longue durée et à la précarité l’ensemble de ceux démunis de tout capital scolaire ou porteurs de diplômes dévalués, étant entendu que, dans un pays qui fut une puissance coloniale, la « concurrence libre et non faussée » sur un « marché du travail » plus sélectif que jamais jouera en défaveur des gens « de couleur » sauf s’ils appartiennent à des familles aisées. Cette thèse propose, enfin et surtout, une vision simpliste, pour ne pas dire caricaturale, propagée par ceux qui s’autodésignent comme les « nouveaux indigènes de la République », en attribuant aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d’immigrés une identité culturelle, qu’ils/elles ne sont évidemment pas tous/toutes disposé-es à endosser. Pour la majorité, l’esclavage remonte à des temps oubliés et l’on ne voit pas pourquoi il faudrait à tout prix les réactualiser au nom du « devoir de mémoire », sauf à vouloir fustiger tous les « blancs » comme descendants de colons ou de négriers.
Il faut dire, et J.-L. Amselle est l’un des rares chercheurs à le souligner, qu’au lieu de parler sans cesse de « minorités » à défendre et à promouvoir, comme on se plaît à le faire dans les campus étasuniens, il serait peut-être temps de poser, au moins pour la France, la question « Qui parle au nom des minorités ? » Point n’est besoin d’avoir lu Pierre Bourdieu pour savoir que les peuples, considérés comme un tout ou découpés en parties, sur des bases ethniques, religieuses, linguistiques ou régionales, « ont rarement la possibilité de s’exprimer en leur nom propre, comme le rapelle l’auteur, et cela en premier lieu parce que leur propre nom est lui-même l’objet d’un enjeu ». En général, ce ne sont pas les groupes sociaux eux-mêmes qui se dotent d’un nom : il leur est attribué non seulement, bien sûr, par ceux qui les dominent, les oppriment, les exploitent, mais aussi par les leaders et les théoriciens qui s’expriment au nom de ces groupes et vont donc les nommer autrement. Un nom évidemment différent dans le second cas.
Là est l’enjeu.
D’où la nécessité de s’interroger sur ces porte-parole autoproclamés :
« quels sont les agents possédant la faculté de nommer une entité sociale quelconque et de la constituer comme telle », de l’ériger en « minorité »,
de la rendre « visible », pour user de l’expression consacrée mais précisément significative sur plan idélologique ? J.-L. Amselle les désignent comme des « entrepreneurs d’ethnicité ». Pourvus d’un capital scolaire acquis à l’université, ils le font fructifier en faisant exister certains groupes sur la scène politoico-idéologique, en leur attribuant une « éligibilté, et une légitimité », qui, comme il se doit, ne peuvent que rejaillir sur ceux qui prétendent les représenter. Non sans risques « d’effet boomerang ».
Réclamées à cor et à cri par ceux qui se sont auto-intitulés et auto-promus « Indigènes de la République », les statistiques ethniques, par exemple, peuvent servir, comme l’expérience historique l’a prouvé, à bien autre
chose qu’à mesurer les discrimations pour les rendre « positives » par
des mesures appropriées. D’une manière générale, les affirmations
« identitaires » des « minorités » ne peuvent, en réaction — terme à prendre aussi avec sa connotation régressive — que « solidifier », pour reprendre une formulation de J.-L. Amselle, « à la fois les identités nationales et européennes, que celles-ci soient conçues comme “blanches”, européeenes, ou les deux à la fois »
Aux antipodes du mot d’ordre post-soixante-huitard, « Français, immigrés, tous unis ! », l’ethnicisation des « violences urbaines », même préconisée pour la bonne cause anti-raciste et anti-discriminatoire, revient à évacuer les remises en question politiques, sociales et économiques, c’est-à-dire des rapports de domination capitalistes, alors qu’ils sont à l’origine de la précarisation, de la paupérisation et de la marginalisation de masse dont
la ségrégation urbaine n’est que l’inscription dans l’espace.
Elle alimente en outre les idéologies de division, d’antagonisme entre dominés (blancs/non-blancs, rebeux/renois, blacks africains/blacks antillais…), incitant les « communautés » à édifier des barrières difficilement franchissables entre les unes et les autres. Victimisation des uns, culpabilisation des autres : la moralisation et la juridicisation qui va avec ont pris la place de la politisation, à la grande satisfaction des classes dominantes qui, elles, ont compris qu’il leur fallait s’entendre entre elles pour perpétuer leur domination.